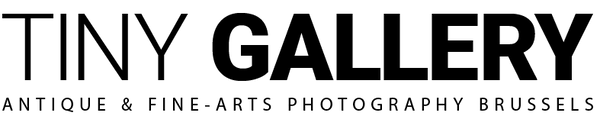Prolongée>03 2026 | Grand art en photographie
Symbolisme, ésotérisme, occultisme (1860-1918) : la photographie durant la période Art nouveau
Une exposition réalisée en collaboration avec la Maison Hannon
La photographie n'a jamais consisté uniquement à capturer la réalité. De l'alchimie à l'intelligence artificielle, elle a toujours révélé des forces cachées, mêlant chimie, mystère et imagination. L'exposition met en lumière la photographie au moment où elle s'affirme comme une œuvre d'art.
Au XIXe siècle, les premiers photographes travaillaient dans des chambres noires, tels des alchimistes modernes, transformant la lumière et les sels d'argent en images impérissables. Leurs « transmutations » chimiques conféraient à la photographie une aura magique, réalisant symboliquement le rêve de l'alchimiste : figer le temps et préserver à jamais un instant fugace. Explorer les débuts de la photographie, c'est donc comprendre non seulement l'évolution de ses procédés chimiques et techniques, mais aussi celle de son langage visuel et de ses sujets.
Au tournant des XIXe et XXe siècles, le mouvement symboliste, né en littérature, inspira des photographes qui, s'inspirant de son imagination, de sa sensibilité et de son goût pour l'allégorie, inventèrent un nouveau langage artistique. Cette période marqua un tournant décisif dans l'histoire de la photographie : celle-ci quitta progressivement le domaine de la documentation pour s'affirmer comme un art à part entière. L'objectif n'était plus de représenter la réalité, mais de créer une expérience sensorielle où l'image devenait un médium capable d'exprimer l'émotion et l'invisible. La lumière, le flou, la profondeur de champ, le contraste et la composition devinrent les instruments d'une quête poétique et spirituelle. À travers eux, les photographes symbolistes cherchaient à saisir l'invisible, à traduire les mystères du monde en utilisant une imagerie alchimique, mythologique, biblique et ésotérique.
Au sein de cette révolution visuelle, la femme s'impose comme un symbole central . Longtemps objet de contemplation – à la fois déifiée, idéalisée et représentée comme une figure de vertu ou de tentation –, elle incarnait les archétypes du mystère et de la révélation. Progressivement, cependant, le regard se déplace : la femme cesse d'être une muse passive et devient un sujet à part entière, choisissant comment se représenter et interrogeant, par là même, notre perception de la féminité. Enfin, elle s'affirme comme créatrice , participante active à la production d'images et à la construction même de la vision photographique.
L'exposition met en lumière ces femmes pionnières qui ont transformé le langage et le regard de la photographie. Julia Margaret Cameron (active de 1864 à 1879) et Frances Benjamin Johnston (années 1890-1920) ont remis en question les représentations conventionnelles de la féminité. Cameron a combiné la douceur du pictorialisme avec le symbolisme préraphaélite, élevant ses modèles au rang de sibylles et de saintes visionnaires ; Johnston, figure emblématique de la Nouvelle Femme américaine, a photographié des étudiantes, des athlètes et des réformatrices, affirmant leur autonomie intellectuelle et professionnelle. Gertrude Käsebier et Anne Brigman ont poursuivi cette voie, imprégnant leur pratique de pensée théosophique et fusionnant quête spirituelle et affirmation de soi.
Entre leurs mains, la surface photosensible devint un espace d'expérimentation où les rôles, les corps et les pouvoirs féminins furent redéfinis en dialogue avec la lumière et la matière. Du corps idéalisé au regard conscient, du modèle à l'artiste, ce changement influença profondément la manière dont les femmes et les hommes abordaient la figure féminine en photographie.
Plusieurs œuvres de l'exposition témoignent de la richesse de cet esprit symboliste, notamment de rares autochromes du peintre pictorialiste belge Alfonse Van Besten (1865-1926). Créées peu après l'apparition du procédé Lumière en 1907, ces diapositives – avec leurs tons veloutés, leur grain pointilliste et leur lumière douce et diffuse – évoquent les vitraux et invitent le spectateur à contempler le seuil où la matière se fond dans la vision.
Organisée en partenariat avec la Maison Hanon, l’exposition réunit des œuvres et des reproductions issues des collections du Musée de la Photographie de Charleroi, du Musée de la Vie wallonne, du Musée des Mines et du Développement Durable de Bois-du-Luc, de la TinyGallery de Bruxelles, du Musée de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège, des Archives et du Musée de la Littérature de Bruxelles, et du Service général du patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous les tirages ont été réalisés à la TinyGallery selon des procédés historiques – papier salé, gomme bichromatée et Van Dyke – dans une réinterprétation respectueuse des œuvres originales.